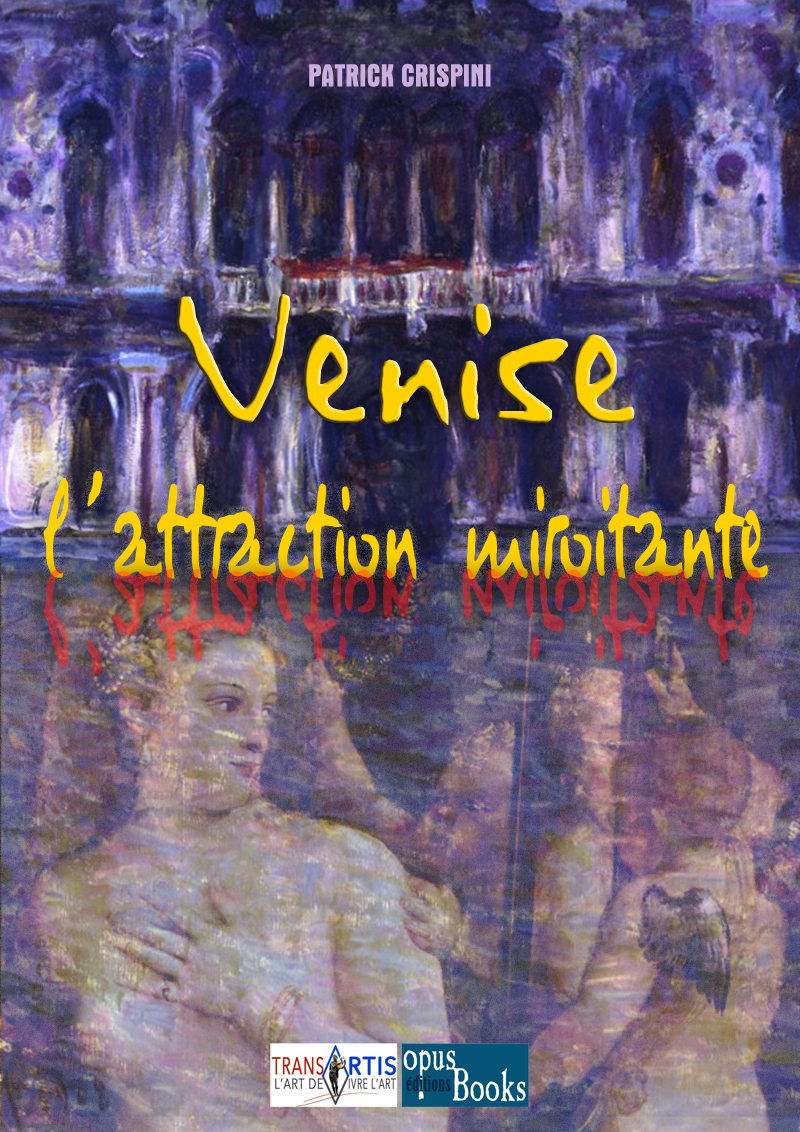Venise, l’Attraction Miroitante
se perdre dans Venise, c’est se retrouver, c’est se retrouver soi-même
par Patrick Crispini
voir aussi : Donna Forcola, la dame de Venise – Wagner, Liszt : la lugubre gondole
voir aussi : Venise Carnaval 2009, photographies – Herveline Delhumeau : Album Venise I – Album Venise II
« Qui la voit une fois s’en énamoure pour la vie
et ne la quitte jamais plus, ou s’il la quitte c’est bientôt pour la retrouver,
et s’il ne la retrouve il se désole de ne point la revoir.
De ce désir d’y retourner qui pèse sur tous ceux qui la quittèrent
elle prit le nom de venetia, comme pour dire à ceux qui la quittent,
dans une douce prière : Veni etiam, reviens encore ».
Luigi Grotto Cieco d’Hadria, Éloge de Venise,
prononcé pour la consécration du Doge sérénissime de Venise
Luigi Mocenigo, le 23 août 1570
Se perdre dans Venise
Il faut se perdre dans Venise.
« Se perdre dans Venise, c’est se retrouver, c’est se retrouver soi-même », nota l’historien et académicien Marcel Brion, qui en connaissait un bout sur la question.
Il faut s’égarer, se dissoudre dans les sestieri (quartiers) de la ville, franchir au hasard quelques-uns des 400 ponts (et sans doute bien plus encore !) sur les rii (canaux) les calle, et s’y arrêter pour profiter des miroitements toujours changeants de la lumière, se laisser guider « à l’oreille » par le timbre varié des centaines de cloches qui, à la fraction de l’heure dite, tintinnabulent dans les campaniles, impétueuses ou frêles, laissant vibrer leurs battement d’airain dans l’air marin, comme pour vous rappeler à de droits chemins… qui n’existent pas dans ce labyrinthe à ciel ouvert (sauf sur quelques cartes pour touristes pressés, qui les conduisent directement vers les boutiques de souvenirs)…
Lever son nez vers les altane – ces petites terrasses suspendues sur les toits, comme des jardins de Babylone -, qui sont autant de balises pour votre navigation pedibus cum jambis, qui le furent aussi pour d’autres rendez-vous amoureux, quand les mamole, ces jolies violettes prêtes à l’amour, s’y trémoussaient pour attirer vers leurs alcôves les passants égarés.
Ici la passeggiata n’est pas que du soir, après la journée de travail, comme dans les autres villes italiennes : on marche Venise comme on la vit, tout le jour, on la déambule de corte en corte, on use ses semelles sur les mazegni (pavés vénitiens), dans les salizzade (les petites rue pavées), puis on peut s’accorder une pause dans un bacaro (bar à vin) où se déguste au verre le vin frais désaltérant.
Bèver un’ombra, andar per ombra (boire une ombre, aller vers l’ombre) : l’ombra, c’est le nom donné par les vénitiens à ce vin d’apéritif, en souvenir des marchands ambulants qui, sur la piazza San Marco, suivaient l’ombre du campanile pour servir leur vin toujours frais.
On le sert ici avec les cicchetti (amuse-bouches), les scie (cigales de mer), les polpette (boulettes de viande)…
Toutes ces choses qui permettent d’entretenir les ciacole, ces bavardages de voisinage qui font qu’ici les murs ont toujours des oreilles. À la rigueur on peut les adoucir avec un autre verre de fragolino (du raisin vitis labrusca au goût typique de fraise).
Tout est courbe à Venise, tout est sinueux, sans issue, tout s’emberlificote dans l’écheveau des ponts, des canaux, des liste (où toutes les ruelles que vous avez prises et reprises, après avoir tourné en rond, aboutissent, au grand dam de votre sens de l’orientation).
Il vous reste le loisir de reprendre vos esprits en lisant le nom de la rue sur les nizioleti, ces petits carrés blancs peints à la chaux à même les murs de briques, mais n’espérez pas trouver facilement le numéro de l’entrée de la Ca’ (la maison) où vous êtes invité : la numérotation se fait à la vénitienne, par quartier et non par rue, ce qui fait que votre arrivée à bon port relève souvent du hasard, sinon du miracle, quand el caigo (la brume, le brouillard) s’est infiltré jusque dans les intérieurs…
« Les canaux de Venise sont noirs comme l’encre ; c’est l’encre de Jean-Jacques, de Chateaubriand, de Barrès, de Proust » écrit Paul Morand et il ajoute : « C’est après la pluie qu’il faut voir Venise, répétait Whistler; c’est après la vie que je reviens m’y contempler. Venise jalonne mes jours comme les espars à tête goudronnée balisent sa lagune ».
C’est quand on n’y voit plus goutte, qu’on ne fait plus que la deviner, qu’on ressent peut-être le mieux cette ville lagunaire, de l’intérieur par l’inspiration de fantomatiques évanescences.
Les eaux ne sont plus alors miroir des mosaïques triomphantes, des régates historiques, des ambassades somptueuses, ni même reflets des palazzi scintillants de tous les lustres de Murano.
Elle deviennent, dans le clapotis des vagues, l’écho silencieux d’un monde suspendu, de toutes les bâtisses montées sur pilotis qui se dressent dans le brouillard, blessées par les outrages du temps, par le moto ondoso des motoscafi, des vaporetti, mais fières et altières, comme un défi à la fatalité de l’engloutissement.
Mais au cadran solaire du jour le mieux, sans doute, reste de héler ses hôtes depuis le calle ou le ramo, car la cité est une caisse de résonance à taille humaine où la voix porte loin.
Ici on fait son marché à gorge déployée, dans la ruga (la rue en vénitien) on vocalise sa commande, on duettise sur le traghetto (la gondole bac), on roucoule sous les sottoporteghi (les porches)…
Le Corbusier, qui savait lire dans les lignes, voyait dans ces circulations naturelles « un trésor inestimable : la quiétude et la joie […] Un système cardiaque pur, impeccable ».
Certaines villes italiennes se parcourent le nez au vent, comme Firenze ou Lucca par exemple, dont les exhalaisons de pâtisseries, de cafés, de charcuteries, émanant des magasins regorgeant de victuailles, vous servent de guide, de boussole, d’aimantation vers le plaisir.
D’autres, où les échoppes des petits artisans n’ont pas encore été avalées par le grand commerce, tout autant parfumées, vous exaltent par la fragrance des laques, des peintures, des bois vernissés…
À Venise aussi flottent dans l’air des senteurs d’artisanat issues des botteghe d’arte : corniciai (encadreurs), remeri (gondoles), maschereri (créateurs de masques en cartapesta (carton-pâte) aidés par les targheri pour les physionomies bouffonnes)…
Mais c’est en écoutant Venise, l’effervescence sonore propagée par ses canaux, que vous trouverez le fil d’Ariane apte à vous guider dans le labyrinthe.
« Où vit-on labyrinthe encombré d’une foule
Qui jamais ne perd son chemin ? »
Jean Cocteau, in Préface à Venise que j’aime, 1951
Jacopo Robusti, dit le Tintoret [1518-1594], Labyrinthe de l’amour (allégorie de la vie humaine), 1538-1552
© Royal Collection Trust © Her Majesty Queen Elizabeth II 2018, Londres
Miroir des eaux
« Quand je cherche un autre mot pour musique, je ne trouve jamais que Venise », disait Friedrich Nietzsche qui, lui aussi, s’y perdit.
Miroir des eaux, miroir des sons.
Miroir funèbre, comme le ressentiront tous les romantiques, échouant dans cette ville qui leur paraît mirage de leur propre anéantissement.
« Vous aimez à vous sentir mourir avec tout ce qui meurt autour de vous ; vous n’avez d’autre soin que de parer les restes de votre vie à mesure qu’elle se dépouille. La nature, prompte à ramener de jeunes générations sur des ruines comme à les tapisser de fleurs, conserve aux races les plus affaiblies l’usage des passions et l’enchantement des plaisirs. Que ne puis-je m’enfermer dans cette ville en harmonie avec ma destinée […] »
Chateaubriand, in Mémoires d’outre-tombe
Mort somptueuse, comme l’évoquera, à son tour, Louis-Ferdinand Céline avec son scalpel sans concession : « J’y fus, savez-vous, à Venise dans ma jeunesse, mon jeune ami… Mais oui ! On y dépérit aussi bien de faim qu’ailleurs… Mais on y respire une odeur de mort somptueuse qu’il n’est pas facile d’oublier par la suite ».
Petite mort à soi-même accordée, renaissant toujours de l’abandon un instant consenti – telle la Fenice, cet opéra qui brûla tant de fois pour revivre plus resplendissant encore -, allégorie du débarcadère romantique où est venue s’échouer la barque silencieuse des illusions perdues (« Devant la chute de Venise, songe à la tienne », écrivait Lord Byron, un autre de ses amoureux transis).
Miroir des crépuscules mordorés, que tant voulurent capturer sur le motif, quand bien même on ne peint pas Venise, sinon pour la figer, la photographier, la coloniser de clichés inlassablement répétés, qui ne rendent qu’un pâle reflet, convenu, stéréotypé, de ce qui en est la vraie substance.
Willian Turner [1775-1851], The Dogano, San Giorgio, Citella, from the Steps of the Europa, 1842 © Tate Gallery, London
William Turner, ce buveur de lait et de whisky, insatiable arpenteur, à la faveur d’errances citadines, s’y était essayé et peut-être fut-il le seul à avoir su saisir ces évanescences fulgurantes, traquées par touches fluides, grattées, frottées, juxtaposées, telles des impressions fugaces, avant même que le mot impressionnisme ne soit inventé…
« Ce ciel – c’est l’infini, mais très visible – liquide, immense, insondable, haletant, qui fond et se coule dans les crevasses des grandes étendues d’une vapeur blanche comme la neige, floconneuse, dont la lente mouvance entraîne le regard le long des vagues infinies jusqu’aux collines euganéennes, îlot où l’œil se repose […] Apparitions de rêve, floues et superbes, les palais innombrables soulèvent leur corps hors des flots creux – pâle rangée de flammes immobiles, dont les tours puissantes s’élancent vers le ciel comme les langues d’un feu plus avide, surplombées de dômes gris, vastes et sombres, comme des mondes éclipsés; les arabesques sculptées et la pourpre du marbre se diluent à mesure qu’on s’en éloigne, lieue après lieue, pour disparaitre dans la lumière du lointain. D’un détail à l’autre, d’une pensée à l’autre, on a l’impression qu’au fond de cet éclatant mystère ils sont aussi inépuisables qu’imprécis, beaux sans jamais se révéler entièrement; secret dans leur plénitude, confus dans leur symétrie, comme l’est la nature elle-même au regard ahuri et vaincu, ils engendrent par ce manque de précision, par cette confusion mêmes, la perpétuelle nouveauté de l’infini, et la beauté. Oui, Monsieur Turner, nous sommes à présent à Venise ».
John Ruskin, in Modern Painters, vol. I
Voir : un diaporama de Monet à Venise en 1908
Musique : Franz Liszt, La Lugubre gondole N°2 par Hüseyin Sermet, pianiste © Naïve 2000
Claude Monet, qui savait de quoi il parlait (« mettez impression » avait-il lâché de guerre lasse à Edmond Renoir (le frère du peintre) qui cherchait pour l’exposition chez Nadar de 1874 à donner un titre évocateur à sa vue du Havre… ce qui allait donner naissance à ce vocable d’impressionnisme, pour lequel, comme Debussy, comme Ravel, il ne cessa d’avoir la plus totale détestation), vint à Venise avec son épouse nourrir les pigeons de Saint-Marc.
Selon son habitude, levé à l’aube, qu’il fasse beau ou qu’il vente, s’étant fait envoyer ses châssis depuis la France, il esquisse 37 toiles durant ce séjour, toiles qui seront achevées en atelier à Giverny entre 1911 et 1912, muni des photographies qu’il avait aussi prises sur place. Mais sa Venise est fantomatique, irradiée.
« Trop beau pour être peint » aurait-il dit à son épouse Alice.
Ne pas gâcher cette lumière pour de vaniteuses élucubrations picturales !
Éviter le piège de l’exaltation descriptive où se perdirent, avant lui, tant de valeureux poètes.
« Ainsi rassurez-vous. Je ne vous vanterai pas le charme mystérieux de la Cité incomparable ; je ne m’exalterai pas sur la beauté lumineuse de la lagune, sur la complexité dédalienne des canaux, sur le pittoresque inextricable des « calli » ; je vous ferai grâce des gondoles et je ne les comparerai ni à des cygnes noirs, à la façon des romantiques, ni à des quartiers de lunes funèbres, à la manière des décadents ; je ne vous ferai pas remarquer l’élégance tout égyptienne de leur fer de proue dentelé qui fait songer à l’épervier sacré qui s’éployait au front de la reine Cléopâtre, ni les rapports que l’on peut découvrir entre la batte d’Arlequin et la rame du barcarol ».
Henri de Régnier, in L’Altana ou la vie vénitienne
Comment conjurer l’attrait du mirage, les périls de l’attraction miroitante ?
Car Venise, en ce domaine, a toujours régné : toute l’aristocratie d’Europe s’est mirée, s’est admirée dans les glaces issues de ses manufactures, et les reflets des bougies de tous les chandeliers, dans les salons et jusque dans les églises, s’y sont démultipliées pour la plus grande illusion qui soit : briller à force de réfléchir, réfléchir à force de briller…
Tiziano Vecellio, dit le Titien [1490–1576], Vénus au miroir, 1555 © National Gallery, London
Miroir de verre
Depuis le XIIe siècle la fabrication du miroir de verre préoccupe les verriers en Allemagne, en Italie, en Lorraine.
Ayant lentement dominé la matière en la travaillant, non plus en bulle avec une canne à souffler, mais en fendant sur sa longueur le cylindre aplati et étalé à chaud sur la sole du four, on obtenait un verre d’épaisseur à-peu-près uniforme, qu’il fallait alors abraser et polir, puis enduire du tain de plomb, d’un alliage de plomb et d’étain.
Mais, malgré le blanchiment à l’oxyde de manganèse, le verre demeurait souillé d’impuretés, sa couleur jaunâtre le rendant peu lumineux.
Au XVe siècle Venise va développer la fabrication des « miroirs au mercure », la plaque de verre étant enduite d’un alliage composé de feuilles de papier d’étain, poncées et lissées, puis du mercure, l’ensemble recouvert par un chiffon de laine ferment maintenu sur la surface par une masse en fer. Il suffit ensuite d’incliner la plaque, afin de la débarrasser du mercure en excès, pour qu’apparaisse la surface miroitante. Les miroirs gagnent alors en pureté, mais demeurent de dimensions réduites, le cylindre de verre soufflé dont ils sont issus ne permettant pas de grandes extensions.
C’est là, vers le milieu du XVIe siècle, que les verriers vénitiens vont accomplir les progrès décisifs : prenant de vitesse les maîtres lorrains, ils parviennent à créer une surface vitreuse d’une clarté parfaite, grâce à des matières premières plus pures (sables, soudes purifiés) et à un étamage plus efficace.
Sertis de leurs cadres d’or et d’argent les miroirs de Venise connaissent une diffusion triomphale, à tel point que la corporation des miroitiers, dans la Sérénissime, est distinguée de celle des verriers, les maîtres artisans, étant autorisés à porter l’épée, jouissant plus que jamais d’une espèce d’immunité de la part de République, se mariant avec les familles les plus opulentes de Venise…
Mais la contrepartie de ces privilèges exige, sous peine de mort, le secret le plus absolu sur les secrets de fabrication, les manufactures et leurs ouvriers étant confinées sur l’île de Murano, sous le contrôle de la police…
Il faut dire que les enjeux sont colossaux : l’art du miroir coûte très cher mais rapporte beaucoup.
Objet d’exportation il reflète dans toutes les cours d’Europe le prestige du rayonnement vénitien, et conforte sa fortune commerciale.
Dès lors les « fuites » vont être nombreuses : des ouvriers, qui avaient réussi à s’échapper, créent des fabriques en Allemagne et en France où les miroirs vénitiens, sous le règne du Roi-Soleil, connaissent un succès sans précédent auprès des aristocrates qui en raffolent et en décorent leurs intérieurs…
À ce point que Colbert, en 1665, va mander à Venise un agent secret pour débaucher les ouvriers spécialisés en leur promettant des privilèges substantiels une fois installés en France : salaire largement au-dessus de ceux pratiqués à Venise, juridiction spécialement afférée à leur corporation, exemption d’impôts et, pour certains, jusqu’à l’anoblissement… Ainsi naît la manufacture royale des glaces… qui permettra d’affirmer, contre Venise, la nouvelle suprématie de la France dans l’art de « miroiter ».
Ainsi, à l’instar de la dentelle des façades en marbre polychrome du Grand Canal, dont les mosaïques mordorées compose une galerie somptueuse reflétant la fortune et le lustre de la Sérénissime aux yeux des ambassades qui, après en avoir remonté le cours, viennent déposer leur hommage au pied du balcon du Doge, Louis XIV décide d’embellir Versailles d’une galerie de 357 glaces, qui doit mener les mêmes ambassadeurs, durant 73 mètres d’une déambulation solennelle, après l’éblouissement et le vertige des miroirs, au pied de son trône solaire.
Tentation du pouvoir absolu de devenir sa propre illusion, en se reflétant dans sa finitude.
« Les miroirs feraient bien de réfléchir un peu plus avant de renvoyer les images », dit la voix de Jean Cocteau dans son film le Sang d’un poète. Dans Orphée, il ajoute : « Les miroirs sont les portes par lesquelles la mort vient et va. Du reste, regardez-vous toute votre vie dans une glace et vous verrez la mort travailler comme les abeilles dans une ruche de verre ».
Le verbe réfléchir, qui provient du latin reflectere, recourber, ramener en arrière, exprime bien l’idée de revenir sur une pensée pour l’approfondir, ce que Bossuet appelle « penser mûrement » dans son Traité de la connoissance de Dieu et de soi-même.
Cheminement d’un repli vers soi, vers la mort, mais aussi vers l’origine, vers la mère.
Marcel Proust à Venise en 1900 (photographie anonyme)
Ainsi Marcel Proust qui, dans Albertine disparue de la Recherche, troublé peut-être par le miroitement des serliane, ces fenêtres palladiennes qu’on trouve partout sur les belles façades vénitiennes, voit s’y encadrer le visage de sa propre mère :
« […] Et parce que, derrière ses balustres de marbre de diverses couleurs, maman lisait en m’attendant, le visage contenu dans une voilette de tulle d’un blanc aussi déchirant que celui de ses cheveux, pour moi qui sentais que ma mère l’avait, en cachant ses larmes, ajoutée à son chapeau de paille, un peu pour avoir l’air « habillée » devant les gens de l’hôtel, mais surtout pour me paraître moins en deuil, moins triste, presque consolée de la mort de ma grand’mère, parce que, ne m’ayant pas reconnu tout de suite, dès que de la gondole je l’appelais elle envoyait vers moi, du fond de son cœur, son amour qui ne s’arrêtait que là où il n’y avait plus de matière pour le soutenir à la surface de son regard passionné qu’elle faisait aussi proche de moi que possible, qu’elle cherchait à exhausser, à l’avancée de ses lèvres, en un sourire qui semblait m’embrasser, dans le cadre et sous le dais du sourire plus discret de l’ogive illuminée par le soleil de midi ; à cause de cela, cette fenêtre a pris dans ma mémoire la douceur des choses qui eurent en même temps que nous, à côté de nous, leur part dans une certaine heure qui sonnait, la même pour nous et pour elles ; et si pleins de formes admirables que soient ses meneaux, cette fenêtre illustre garde pour moi l’aspect intime d’un homme de génie avec qui nous aurions passé un mois dans une même villégiature, qui y aurait contracté pour nous quelque amitié, et si depuis, chaque fois que je vois le moulage de cette fenêtre dans un musée, je suis obligé de retenir mes larmes, c’est tout simplement parce qu’elle me dit la chose qui peut le plus me toucher : « Je me rappelle très bien votre mère ».
Marcel Proust, in La Recherche du temps perdu, Livre VI – Albertine disparue
On n’en finirait plus de convoquer les plumes, les palettes, des peintres, écrivains, essayistes, poètes, cinéastes, philosophes, musiciens, chorégraphes, danseurs, géographes et historiens, qui succombèrent à l’envoûtement vénitien, et y laissèrent parfois jusqu’à leur raison.
Alphonse Allais s’en dédouanait en y déplorant « l’absence totale de parfum de crottin de cheval ».
Sylvain Tesson, quant à lui, observe avec sa fine ironie, dans ses Aphorismes sous la lune et autres pensées sauvages, que l’« on a fait couler tellement d’encre sur Venise qu’elle se noie ».
Inutile donc de se noyer dans les eaux du Grand Canal, ni dans la foule qui l’envahit chaque matin. La noyade, depuis le temps où l’on précipitait de nuit les condamnés depuis le Rio degli Orfani, après les avoir laissés croupir dans les geôles des Piombi (les Plombs), n’est pas la bonne façon d’en finir à Venise.
On ne se noie pas dans une ville qui, elle-même, sombre peu à peu. D’autant que, comme la musique chère à Baudelaire, elle est sans cesse recommencée…
« À Venise, plus de crêtes détachées dans le diamant de l’atmosphère, plus de lignes impérieuses découpant sur le ciel les collines et les terrasses étagées. Rien que l’espace où les choses tremblent, se combinent et se dissocient, un monde de reflets que modifient, intervertissent, suppriment, multiplient les heures du jour et les saisons, une opale mouvante où les irisations de la lumière, à travers la poussière d’eau, interdisent de définir les couleurs et les lignes, font apparaître les formes mêmes comme des objets transitoires qui sortent sans arrêt de la matière en mouvement pour y rentrer et s’y refondre avant d’en ressortir. Sur les palais mordorés ou pourpres ou recouverts de croûtes d’or moisies, toutes les couleurs du prisme s’éveillent, s’effacent, renaissent, se prolongent en traînées épaisses, avec les contours tremblotants des pierres, dans l’eau grasse où la fermentation des matières organiques fait rouler des phosphorescences. Le miroir de la mer a ses reflets dans les vapeurs qui montent d’elle sous la pluie des rayons, et quand elles passent en nuées au-dessus des canaux miroitants, le ciel leur renvoie des ombres glauques et réfléchit le fantôme aérien des moires où le clapotement des vagues mêle la turquoise et le vermillon, les verts, les jaunes d’or, les rouges, les orangés des façades ornées de drapeaux et des cortèges de gondoles ».
Elie Faure (1873-1937), in Histoire de l’art, l’Art renaissant, vol. III
« J’écris toujours avec un masque sur le visage ;
Oui, un masque à l’ancienne mode de Venise,
Long, au front déprimé,
Pareil à un grand mufle de satin blanc.
Assis à ma table et relevant la tête,
Je me contemple dans le miroir, en face
Et tourné de trois quarts, je m’y vois
Ce profil enfantin et bestial que j’aime.
Oh, qu’un lecteur, mon frère, à qui je parle
A travers ce masque pâle et brillant,
Y vienne déposer un baiser lourd et lent
Sur ce front déprimé et cette joue si pâle,
Afin d’appuyer plus fortement sur ma figure
Cette autre figure creuse et parfumée ».
Valéry Larbaud, Le masque,
in Poésies de A.O. Barnabooth
Sous le masque
Il faut plutôt se perdre dans Venise. S’y faire oublier.
Et plus encore, durant son Carnaval, sous un masque.
Le masque, plus que tout autre subterfuge, exacerbe cet art de se perdre, d’annihiler le je ordinaire pour un jeu plus subtil, où vous devenez à la fois l’observateur et le regardé, celui qu’on contemple dans les atours convenus ou sublimés d’un temps de Carnaval, lui-même écho de rites ancestraux et du théâtre antique. Seul votre regard s’offre à de possibles assauts de séduction, l’ensemble vous livrant à l’anonymat dans les rues nocturnes.
Le mot vient de maska (noir), que l’on retrouve dans maskara et qui rappelle que la première manière de dissimuler son visage était de le noircir. Mais, à Venise, seule la moretta, petit ovale de velours, est de couleur noire : réservée aux femmes, son petit bouton à l’emplacement de la bouche obligeait celle qui le portait à rester muette.
Ce n’est pas le cas du masque blanc traditionnel, qu’on nomme bautta – mot qui recouvre tout l’ensemble du costume, composé du volto ou de la larva, le masque proprement dit, du tabarro, la cape noire, et du tricorne.
À l’époque du libertinage – dont Venise s’était fait une spécialité attirant de toute l’Europe une belle société en quête de privautés, de frivolités licencieuses – il était possible, sans se départir de sa bautta – la partie basse étant ingénieusement profilée en avant – de mener son babil, ses conquêtes et même de boire et de manger.
C’est dans cet équipage, porté l’année faite, que vous eussiez pu vous rendre incognito à de galants rendez-vous, intriguer dans vos cénacles politiques ou, tout aussi bien, organiser le guet-apens dans quelque coupe-gorge dont la Sérénissime ne manquait pas.
Car Venise, dans ces temps encore brûlant de l’Inquisition mais entrant dans les âges baroques, n’était pas seulement cette prolifique vitrine des Doges, contrôlant loin à la ronde les routes des soies et des épices, des comptoirs maritimes, mais un déduit du sexe posé sur la lagune, un atelier de Vénus, où ce commerce était, depuis longtemps contrôlé de près.
Il y avait eu les six magistrats – un pour chaque quartier de la ville – des Seigneurs de la nuit, auxquels la loi de 1266 édictée par le gouvernement vénitien avait confié la charge d’appliquer les mesures contre la prostitution aux heures nocturnes, notamment auprès des furatole et des bastioni, ces établissements de mauvaise vie où l’on se procurait à vil prix du vin et des filles, et de contrôler les patrone et matrone (maquereau et maquerelles…) administrant les trafics érotiques, en prélevant au passage « la dîme » souveraine.
Tout cela avec la bénédiction de l’église, selon les préceptes de saint Thomas :
« La prostituée doit aujourd’hui être tolérée dans la cité pour éviter des maux pires encore comme la sodomie, l’adultère ou autres méfaits semblables. C’est pourquoi c’est une décision juste du législateur d’autoriser les transgressions mineures pour en éviter de plus graves. Dans les régimes humains, ceux qui gouvernent tolèrent justement quelques maux afin que le pire ne se produise pas ».
Au 15e siècle le Conseil des Dix avait créé la commission du Collège des Sodomites, apte à engager les procédures discrétionnaires pour les mœurs jugées dégradées.
Au 16e siècle, dans une cité qui comptait alors plus de 150 000 habitants, la magistrature des Inspecteurs aux Pompes avait pris le relais, chargée de réprimer les dépenses un peu trop voyantes des courtisanes et l’abus des « fenêtres de l’enfer » où les belles affriolantes exhibaient leurs appâts mamellaires depuis les premiers étages donnant sur la Fondamenta delle tette (« la voie des tétons », la dénomination existe encore), vers San Caciano.
La mamola (jolie terme, rappelant la fleur de violette), la meretrice (prostituée pécheresse), la bagattine (le menu fretin…) se trouvant mieux intégrées dans la société, le règne de la courtisane allait alors pouvoir commencer (il durera jusqu’au 20e siècle, au bonheur et malheur des visiteurs de passage) : Veronica Franco – la plus célèbre – la Gasparina (Gaspara Stampa, poétesse à ces heures), Angela dal Moro dite la Zaffetta (toujours accompagnée de son zaffo, une sorte de chaperon, d’où son surnom).
Montesquieu, qui connaissait l’esprit des lois, relève dans ses Carnets de voyages de 1728 ce proverbe vénitien évocateur : « Le matin, une petite messe, après le repas une bassetta (jeu de cartes) et, après dîner, une petite femme ».
Giandomenico Tiepolo [1727 – 1804], Polichinelle portraitiste dans son atelier, vers 1802 © Collection particulière
Il cammino : le chemin intérieur
Camminare (cheminer) : se perdre dans Venise, dans sa brise marine, ses venelles où résonnent tant de pas de marcheurs égarés. La marche, dans son lointain sens originel de frontière, de marque (marka), ne foule-t-elle pas aux pieds le cadre des certitudes pour un vagabondage qui s’exile du domicile ?
« […] Nulle part on ne se sent plus seul que dans la foule à travers laquelle on se presse, absolument inconnu de chacun », notait Goethe dans son Voyage en Italie, le 28 septembre 1786, alors qu’il découvrait Venise pour la première fois.
Se perdre pour se retrouver, se déprendre pour mieux se reprendre.
Le masque de carnaval n’est pas seulement le rideau de théâtre qui vous dissimule, la bautta, le costume qui vous affranchit. Jusqu’à Torcello, où réside un secret de mosaïques, dans les marqueteries des Scuole, les stucs et putti des palais investis par les nouveaux riches, les vierges de Bellini, la ligne savante de la gondole, de la fórcola, et même jusque dans l’assiette – de bigoi in salsa, castradina ou tiramisù – le masque n’est que le prologue de plus profondes déambulations, où Venise, vasque miroitante dans la brise marine, moire ondulante dans la nuit lagunaire, vous enferme peu à peu dans ses filets d’azur.
« Ce qu’un homme ne sait pas ou ce dont il n’a aucune idée
se promène dans la nuit à travers le labyrinthe de l’esprit »
Johann Wolfgang von Goethe
Il faut se perdre dans Venise...
Venise, un labyrinthe à ciel ouvert… © PC transArtis 2015